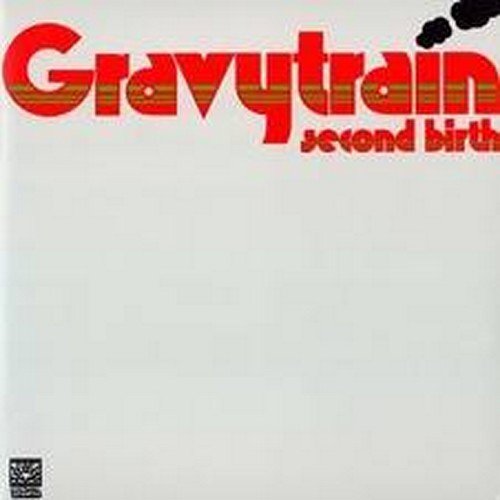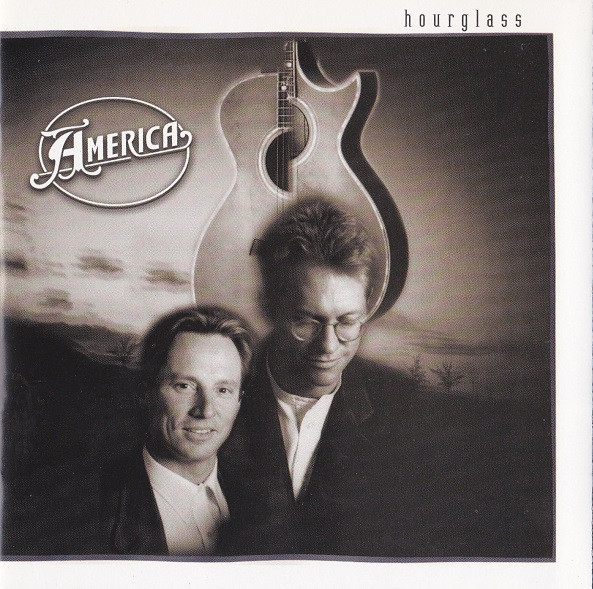All Things Must Pass (1970)
En 1970, l'année où les Beatles se séparent officiellement, le divorce est dans l'esprit des Américains. Un an plus tôt, Ronald Reagan, alors gouverneur de la Californie, avait signé la première loi sur le divorce sans faute du pays, libérant les couples de l'obligation de produire des preuves de faute pour légaliser leur séparation. De 1965 à 1970, le nombre de demandes de divorce a presque doublé et, dans le sillage de lois similaires en cours d'adoption dans d'autres États, le taux a grimpé en flèche au début de la décennie suivante. Au moment où Kramer Vs. Kramer remporte le prix du meilleur film en 1980, le nombre de divorces a encore presque doublé. Mais 1970 reste un point d'appui mystérieux : Chaque fois qu'une nouvelle étude est publiée sur les taux de séparation, notre progression ou notre régression est toujours mesurée "depuis 1970".
Comme tout ce que les Beatles ont fait, leur dissolution cette année-là a inventé une nouvelle façon pour un groupe d'être - dans ce cas, douloureusement et publiquement divisé. Dans leur agonie, le groupe est devenu le divorce par procuration de la musique rock pour la décennie suivante. Tout comme il y avait un Beatle Fab Four pour chaque adolescent découvrant les frissons du rock and roll dans les années 60, il y avait un Beatle divorcé pour chaque adolescent pris entre des parents qui hurlaient dans les années 70. Les albums solos sont apparus immédiatement, comme des bleus sur une blessure, et chacun d'entre eux avait la qualité d'un argument apporté à une déposition, d'une version de l'histoire défendue. Paul a filé à toute allure vers un nouvel amour et une deuxième vie de famille ; John a regardé les parties les plus laides de lui-même et a pleuré ; Ringo s'est retiré dans les standards schmaltzy pré-rock 'n' roll de sa jeunesse.
Et puis il y avait George, qui expirait profondément, s'étirait et s'épanouissait. "J'avais tellement de chansons en réserve que je voulais vraiment faire, mais je n'avais que mon quota d'une ou deux chansons par album", a-t-il déclaré avec modération au Dick Cavett Show en 1971, faisant référence à la période de plus en plus tendue, depuis The White Album jusqu'à Let It Be et Abbey Road, où chacun des trois principaux auteurs-compositeurs du groupe s'était tellement attaché à sa vision individuelle qu'il commençait à voir les autres dans la pièce comme des obstacles. "Au cours de la dernière année environ, nous avons élaboré quelque chose qui était encore une blague, vraiment", avait-il déclaré à Howard Smith un an auparavant. "Trois chansons pour moi ; trois chansons pour Paul ; trois chansons pour John, et deux pour Ringo !" Les dernières sessions d'enregistrement officielles des Beatles, pour l'album Let It Be, ont lieu les 3 et 4 janvier 1970 ; John n'est même pas présent, en vacances avec Yoko Ono au Danemark. Comme il se doit pour un groupe qui s'était tellement consumé par les conflits, la dernière chanson des Beatles enregistrée sur bande fut "I, Me, Mine", et plus encore, c'était une chanson de George Harrison.
Avec son propre studio, sa propre toile et son propre espace, Harrison a fait ce qu'aucun autre Beatle solo n'a fait : Il a changé les termes de ce que pouvait être un album. Les historiens du rock considèrent All Things Must Pass comme le premier "véritable" triple album de l'histoire du rock, c'est-à-dire trois LP de matériel original et inédit ; le LP du concert de Woodstock, sorti six mois auparavant, est son seul antécédent. Mais dans l'imaginaire culturel, c'est le premier triple album, le premier sorti comme une déclaration pointue. Avec sa colonne vertébrale grave et redoutable, sa photo de Harrison à la campagne, symboliquement chargée, entourée de trois nains de jardin renversés, il s'impose toujours comme un livre relié de cuir, une bible de la King James de la musique pop sur n'importe quelle étagère de disques qu'il occupe. C'est l'un des premiers objets de ce type dans l'histoire de la musique pop, le triple album encombrant qui a déversé des océans de vinyle noir, imprimé des milliers de feuilles de paroles, traversé plusieurs faces et vous a fait vous lever et vous rasseoir cinq fois, marchant un demi-mile entre votre canapé et votre chaîne stéréo pour vivre tout cela. C'était l'album solo des Beatles le plus lourd et le plus important, le premier objet de la chute des Beatles à tomber du ciel et à atterrir avec fracas dans une génération de salons. C'est un hymne à l'ambition, à l'envie de dire trop de choses pour tenir dans un espace restreint, et pour cette seule raison, il reste l'un des albums les plus importants de tous les temps.
Il est également très populaire, malgré son prix de vente élevé ; All Things Must Pass passe sept semaines à la première place, et son single principal, "My Sweet Lord", occupe la même place dans le classement des singles, marquant la première fois qu'un Beatle solo occupe les deux places. Ce succès est une douce justification pour Harrison ; son triomphe est si retentissant que ses anciens partenaires ne peuvent feindre de l'ignorer. "Chaque fois que j'allume la radio, c'est "‘Oh my lord’", plaisante sèchement John Lennon à Rolling Stone. Les rumeurs disent que John et Paul ont réagi avec chagrin en entendant l'abondance de matériel qui se déverse sur l'album, saisissant enfin la profondeur du talent qu'ils avaient mis du temps à reconnaître. Leurs albums solo seront considérés comme des succès à des degrés divers, chacun à leur manière, mais seul George a eu le vent de la vraie surprise dans le dos.
All Things Must Pass avait la qualité d'une conversation interrompue et reprise des années plus tard ; il y avait ici de superbes chansons que Harrison avait apportées au groupe, mais qui avaient été accueillies avec plus ou moins d'indifférence. " Isn't It a Pity " avait été rejetée de Revolver, tandis que " All Things Must Pass " avait été refusée pour Abbey Road. Avec le recul, il est impossible d'imaginer que ces chansons aient la moitié de l'impact qu'elles auraient eu si elles avaient été prises en sandwich entre, disons, "Don't Pass Me By" et "Why Don't We Do It in the Road". Prises ensemble, elles ont leur propre poids et leur propre profondeur cumulés ; vous pouvez même imaginer que leurs démos semblent peut-être trop patientes ou trop laborieuses pour les trois autres. Ben Gerson, qui en faisait la critique dans Rolling Stone à l'époque, la comparait au romantisme germanique de Bruckner ou de Wagner, des compositeurs qui n'avaient pas peur de risquer un peu de lourdeur pour atteindre des sommets grandioses. Harrison a peut-être nourri des rancœurs, mais ses anciens camarades de groupe lui ont fait une faveur perverse en lui laissant ce matériel : C'est la musique de la solitude satisfaite, et elle n'a de sens que par elle-même.
Outre John, George était le seul Beatle qui n'avait pas peur d'écrire sous le coup de la colère ou de la négativité - ses premiers morceaux des Beatles, comme "Think For Yourself" et "Taxman" sont presque surprenants dans leur fiel. Mais là où John se déchaînait et parfois se vautrait, George explorait doucement ; lorsque John Lennon tapait du poing en hurlant qu'il était "malade et fatigué d'entendre des choses de la part d'hypocrites coincés, myopes et étroits d'esprit", George notait simplement qu'il était "dommage" que "peu de gens/ puissent voir que nous sommes tous pareils". La mordante "Wah-Wah", produite par Phil Spector et composée de tellement de pistes de guitare différentes qu'elle ressemble à trois chansons rock à guitare qui se combattent, est probablement la missive la plus pointue de Harrison en tant qu'artiste solo, adressée à ses anciens camarades de groupe de plus en plus aliénés. Mais même ici, il semble plus décontenancé qu'énervé ; le swoop et le dip des mélodies et l'anticyclone du riff principal ressemblent plus à des gloussements qu'à des cris, et les paroles les plus résonnantes ("And I know how sweet life can be/ If I keep myself free") sont le son d'une âme hésitante qui s'autorise un bâillement mesuré de liberté, aussi provisoire et prudent soit-il.
La musique de Harrison de cette époque embrasse la philosophie orientale qu'il a découverte en étudiant avec le Maharishi et qu'il suivra assidûment tout au long des années 70. Lorsqu'on l'interrogeait sur ces idées lors d'interviews, il pouvait passer pour un grondeur un peu fatigué, et ses explorations mystiques de l'époque des Beatles avaient parfois l'austérité surcompensatrice d'un étudiant. Mais All Things Must Pass, bien qu'il s'agisse facilement de la déclaration la plus spirituelle d'un Beatle, est une œuvre plus sage, faite par quelqu'un dont les idées dures ont été adoucies et attendries par une série de coups salutaires. Il y a une chanson intitulée " Let It Down " et une autre sous-titrée " (Let It Roll) " - de simples expressions d'abandon de la part de quelqu'un qui a appris exactement ce qu'il peut et ne peut pas contrôler. La chanson titre tourne autour d'une phrase qui ressemble autant à "It's not always gonna be this grey" qu'à "it's not always gonna be this great" ; les deux interprétations sont tout aussi valables (même si le texte réel est "grey"). "Il est temps de commencer à sourire/Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?", demande-t-il sur le country-rock chatoyant de "Behind That Locked Door".
Et, bien sûr, il y avait "My Sweet Lord", la chanson qui, volontairement ou non, suivait directement les traces de "He's So Fine" de The Chiffon. Harrison a finalement été poursuivi pour ce qu'un juge a appelé du "plagiat inconscient", ce qui pourrait être un bon euphémisme pour "écriture de chansons pop". La situation est doublement ironique compte tenu de la générosité intrinsèque de Harrison en tant qu'artiste. L'album est une fête de collaboration en soi, un rassemblement dans lequel Eric Clapton, Ringo, Billy Preston, le futur batteur de Yes, Alan White, et même un jeune Phil Collins, jouant des bongos sur "Art of Dying", ont eu leur place.
Ayant été mis à l'écart trop souvent auparavant, il semble qu'il ne veuille absolument pas faire la même chose aux autres.